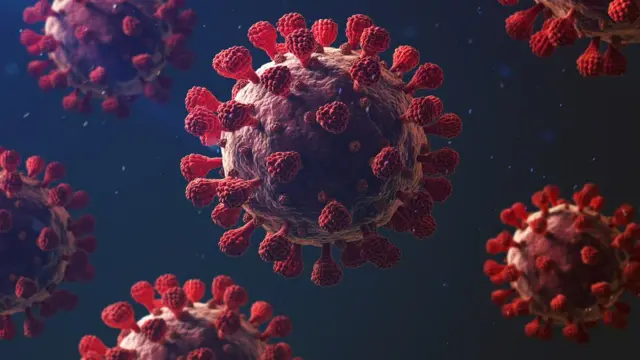Aujourd’hui, le coronavirus ne touche encore que des pays pouvant faire face à une urgence sanitaire. Mais l’hypothèse d’une extension à l’Afrique fait redouter le pire.
Ce n’est pour l’heure qu’une hypothèse, mais elle est très redoutée, jusqu’aux plus hautes instances de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Que se passerait-il si l’épidémie de coronavirus chinois s’étendait à l’Afrique ? Le Centre pour les études stratégiques internationales (CSIS) à Washington a évoqué ainsi le pire des scénarios, qui serait « le prélude à une pandémie mondiale ».
À ce jour, aucun cas de coronavirus n’a été déclaré sur le continent africain. Mais l’inquiétude plane, car si des cas étaient exportés « vers certains pays d’Afrique ou d’autres continents où les moyens de sécurité sanitaire sont limités, de gros foyers épidémiques pourraient alors éclater hors de Chine », poursuit J. Stephen Morrison, du CSIS. En clair, une expansion en Afrique de l’épidémie lui donnerait une tout autre envergure.
La question se pose avec d’autant plus d’acuité que, on le sait, la Chine a largement investi le territoire africain. Trente-neuf pays du continent sont sur la carte des « Nouvelles routes de la soie » sur lesquelles s’étend le développement commercial chinois. En 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent, devant les États-Unis et la France. Huit ans plus tard, des sources officielles évaluaient à plus de 200 000 le nombre de travailleurs chinois en Afrique – particulièrement en Algérie, en Angola, au Nigeria, en Éthiopie et en Zambie. Certains d’entre eux sont évidemment amenés à revenir chez eux régulièrement, pouvant servir de relais pour le virus.
Une « urgence internationale » pour l’OMS
C’est cette inquiétude non dissimulée qui a poussé l’OMS à déclarer jeudi l’épidémie comme « une urgence de santé publique de portée internationale ». « Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles. Il ne s’agit pas d’un vote de défiance à l’égard de la Chine », s’est empressé de préciser le directeur de l’institution, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’OMS n’a jusqu’ici utilisé le terme d’ »urgence de santé publique de portée internationale » que pour de rares cas d’épidémies requérant une réaction mondiale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 et la République démocratique du Congo depuis 2018.
En effet, l’arrivée du 2019-nCoV pourrait y faire des dégâts humains considérables. « Aujourd’hui, dans les pays développés, l’avancement de la maladie n’est pas encore très inquiétant et on peut proposer aux malades de simplement rester chez eux pour ne pas contaminer d’autres personnes. Mais cette option n’est valable que si, d’abord, les personnes sont déjà en bonne santé, et ensuite, si elles ont accès à des ressources de santé autour d’elles. Dans un certain nombre de pays africains, c’est tout ce qui fait défaut », explique à L’Express Michèle Legeas, enseignante à l’École des hautes études de la santé publique (EHESP), experte de la gestion des situations à risques infectieux.
« Si la maladie arrive dans ce contexte, elle va exploser »
« Les gens sont déjà en mauvaise condition alimentaire, ils font l’objet d’autres pathologies y compris infectieuses sous-jacentes : paludisme, troubles intestinaux, pneumopathies… En Afrique, beaucoup d’enfants souffrent déjà d’infections respiratoires aiguës, et seraient donc particulièrement fragiles à ce virus qui affecte les poumons », ajoute-t-elle.
Parmi les pays les plus fragiles sur un continent très contrasté, les experts désignent la Sierra Leone, déjà très touchée par le virus Ebola, le Yémen, fortement atteint par le choléra, le nord du Mali et du Burkina ; des zones où des guérillas internes font rage et où les États sont en déliquescence. « Dans ces régions, il n’y a plus de maire, plus d’instituteurs, plus de médecins. Si une maladie contagieuse s’ajoute aux problèmes de types de zones, elle va forcément exploser », s’alarme Michèle Legeas.
Deux choses permettent toutefois de relativiser ce pessimisme. D’une part, les caractéristiques du 2019-nCoV, qui en l’état actuel des connaissances n’est pas d’une plus grande contagiosité que la grippe. Et le fait que les scientifiques du monde entier travaillent à mieux connaître ce virus, avant qu’il n’arrive dans des États plus fragiles. « On s’y prépare », confirme à L’Express Marc Gastellu Etchegorry, médecin épidémiologiste à Médecins sans frontières. On travaille avec les autorités de santé, on a envoyé des observateurs en Chine et on remonte les infos à deux laboratoires présents en Afrique, au Niger et en Ouganda.
Coronavirus : le scénario catastrophe d’une contamination en Afrique
Aujourd’hui, le coronavirus ne touche encore que des pays pouvant faire face à une urgence…
Border Collie croisé Labrador ou Borador : tout savoir sur cette espèce
Vous recherchez un chien intelligent, athlétique et affectueux ? Pensez au border Collie croisé Labrador,…
Redonner vie à une voiture ancienne : astuces et conseils pour restaurer un véhicule d’époque
Vous êtes passionné de voitures anciennes et vous avez décidé de vous lancer dans la…